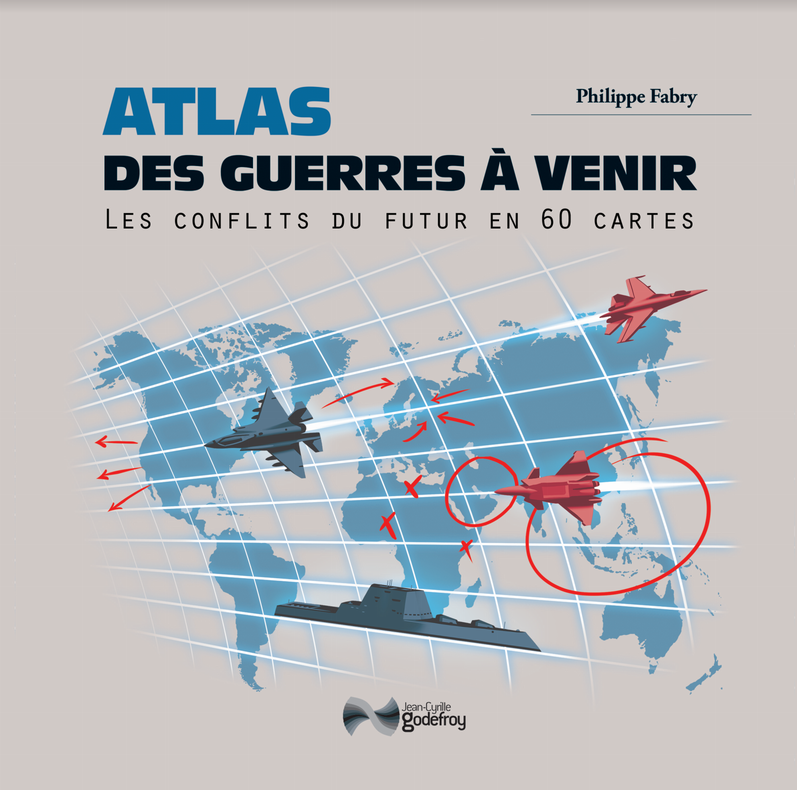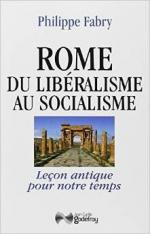Départementales : vers la recomposition (libertarienne ?) du paysage politique français
Or donc, chose promise, chose due, après une semaine de « replays » consacrés à mes précédents articles sur le clivage gauche-droite et sa dynamique, vient le moment de produire quelques éléments d’analyse du résultat des départementales de dimanche dernier en considérant mes lecteurs comme suffisamment informés de la manière dont les choses, fondamentalement, fonctionnent. Place aux travaux pratiques.
Evidemment, je n’attends pas les résultats du second tour, car ils n’apprendront pas grand-chose : pour étudier l’évolution du spectre politique, c’est le premier tour qui est essentiel, celui où l’on observe le plus fortement un vote d’adhésion, contrairement au vote largement par défaut, par compromis, du second tour.
Pour visualiser ces résultats du premier tour, je reprendrai à mon compte le beau graphique livré par h16, d’abord parce qu’il est bien fait et que je ne saurais faire mieux, ensuite parce qu’il reprend (partiellement) les chiffres officiels et donne donc une bonne visualisation des résultats.
Certes, ces chiffres sont partiels puisqu’il n’y a pas eu 16 millions mais vingt millions de suffrages exprimés. Les chiffres complets se trouvent sur le site du ministère de l’intérieur. Il est intéressant de les consulter, car l’on réalise alors que le Front National a fait près de 5,2 millions de voix, ce qui est 400 000 de plus que lors du fameux 21 avril 2002, et seulement 400 000 de moins que lors du deuxième tour de la même élection qui avait, on l’imagine, particulièrement mobilisé l’électorat du Front National. C’est donc un record pour le premier tour d’une élection, et spécifiquement pour le premier tour d’une élection locale. Certes, l’on doit pondérer ceci par le fait que l’électorat FN, soucieux de montrer la force de sa dynamique actuelle, s’est mobilisé de manière plus importante que les autres électorats ; par conséquent on ne doit pas imaginer que le FN disposerait, dans une élection présidentielle, d’une réserve supplémentaire de voix comparable à celle qui est imaginable pour l’UMP et le PS, dont les électeurs se trouvent sans doute en grand nombre chez les abstentionnistes.
Néanmoins, il me semble qu’il y a tout de même des enseignements à tirer de ces chiffres, et qu’il vont dans le sens de mes précédentes conclusions.
La première chose qui saute aux yeux, en observant le graphique, c’est l’impressionnant déséquilibre entre droite et gauche, et spécialiement entre extrême-droite et extrême-gauche. En additionnant les chiffres du ministère, l’on obtient les données suivantes : sur 20 372 060 suffrages exprimés, l’extrême-gauche totalise 1 258338 voix, la gauche modérée 6 230466 voix, la droite modérée 7 243320 voix et l’extrême-droite 5 237540 voix ; pour les centristes difficiles à répartir : 402 396. Total gauche : 7 488 804 voix ; total droite : 12 480860, soit 61,26 % des suffrages exprimés.
Dans quelle mesure ce déséquilibre gauche-droite est-il significatif ?
Il est évident que ce déséquilibre tient à la puissance électorale du FN : s’il faisait un score inférieur de moitié, ou si simplement l’extrême-gauche était un peu plus forte, l’écart serait moindre. Mais au total, l’extrême-droite fait plus de quatre fois le score de l’extrême-gauche.
L’analyse de la montée du FN diffère selon le bord politique : les gens de gauche parlent de « droitisation de la société », tandis que les électeurs de droite modérée évoquent un Front National qui serait désormais un « parti de gauche ». Au FN, on dira plutôt que c’est le clivage qui est dépassé.
En réalité, tous ces points de vue sont également erronnés, mais fondés sur des appréhensions partiellement correctes, mais mal interprétées.
Ainsi, la société ne se « droitise » pas au sens où l’entendent ceux qui emploient ce terme, à savoir que des thèmes défendus par la droite s’imposeraient, en une sorte de régression idéologique ; en revanche, l’on constate effectivement que, à mesure qu’une idéologie venue de la gauche - en l’occurrence, le socialisme - devient hégémonique à droite, la gauche s’affaiblit, perd son attrait spécifique : aujourd’hui défendre le socialisme, en France, ce n’est plus être révolutionnaire, comme à la fin du XIXe siècle, et ce n’est même plus être réformiste, comme c’était encore le cas en 1981, c’est simplement être conservateur. Et en l’absence d’une nouvelle idéologie venant susciter l’enthousiasme au sein de la population de sensibilité « de gauche », celle-ci se désintéresse du jeu politique. Il n’est donc pas faux que la population se « droitise » en ce qu’elle devient plus conservatrice ; mais le fait est que ce qu’elle veut conserver, c’est le modèle social socialiste. La véritable droitisation n’est pas le fait que la population devienne réactionnaire, souhaite revenir sur un certain nombre d’évolutions, mais le fait que ceux qui, hier, ont porté ces évolutions, en refusent de nouvelles.
De même, le Front National n’est pas un parti « de gauche » ; ceux qui disent ceci confondent gauche et socialisme et j’ai, je pense, assez démontré que c’est une erreur. Les partisans de cette analyse affirment souvent que le Front National aurait « gauchisé » son discours pour attirer les ouvriers et de nombreux déçus de la gauche, mais en réalité ce n’est pas le FN qui s’est gauchisé, c’est le socialisme qui s’est « droitisé », qui a glissé vers la droite et atteint l’extrême-droite. Or, si le socialisme de droite n’était pas apte à emporter l’adhésion des gens de sensibilité révolutionnaire, d’extrême-gauche, le discours « antisystème » qui caractérise toujours l’extrême-droite peut y parvenir (cf. mes deux premiers articles et ce que je disais sur les « conservateurs » au sens large (conservateurs et progressistes) et les « révolutionnaires » au sens large (réactionnaires et révolutionnaires)). C’est pourquoi, alors que nous sommes dans une situation économique et sociale difficile et que les extrêmes devraient représenter électoralement environ 15% chacun, l’extrême-gauche ne représente que 5% et l’extrême-droite 25%. Ce n’est nullement un hasard, à mon avis, si il y a un demi-siècle le Parti Communiste Français faisait 20% alors que l’extrême-droite était pratiquement inexistante. En cinquante ans, la proportion s’est inversée, de même que le vieux parti russe d’extrême-gauche est devenu le parti russe d’extrême-droite, et l’internationalisme communiste est devenu l’européanisme poutiniste.
Quant à l’affirmation FNiste selon laquelle le clivage gauche-droite serait dépassé et n’aurait plus de pertinence, tout individu connaissant le mot d’Alain songera qu’elle est précisément une affirmation d’homme de droite. Cependant, tout comme les deux précédentes analyses, celle-ci a un fond de vrai : il règne effectivement un relatif unanimisme entre les modérés de l’UMP et du PS également sociaux-démocrates ; en outre, en l’absence d’une extrême-gauche proposant une idéologie alternative de celle du FN, ce qui supposerait, dès lors que celle du Front National est essentiellement une version droitière du socialo-communisme s’étant imposé à gauche dans le premier quart du XXe siècle, que ladite extrême-gauche se soit dotée d’une nouvelle idéologie distincte, il faut bien avouer que le FN est le seul grand parti d’opposition à cet ordre établi, à ce consensus politique, comme l’était le boulangisme à la République libérale dans les années 1880.
Le clivage gauche-droite n’a donc pas disparu, il n’est pas dépassé (il est même indépassable, par définition, en ce qu’il est distribution d’une population entre réactionnaires, conservateurs, progressistes et révolutionnaires) mais il est cependant dans une phase très spécifique, de déséquilibre critique, qui appelle un basculement.
Telle est la conclusion que je tire de la montée du Front National : je ne pense pas qu’il s’agisse d’un phénomène conjoncturel, lié à la crise et à des élections de mi-mandat dans un contexte économique et social particulièrement désastreux ; cela n’expliquerait en effet nullement le différentiel important entre le résultat de l’extrême-droite et celui de l’extrême-gauche. En 1960, l’extrême-droite était quasi-inexistante car sa principale composante idéologique, le monarchisme, s’était éteinte sans être encore remplacée par rien ; c’est le souverainisme eurosceptique qui lui a permis, petit à petit, de se reformer ; à l’inverse et dans le même temps, à l’extrême-gauche, l’idéologie socialo-communiste a vieilli, et n’a aujourd’hui plus aucune vigueur intellectuelle. A vrai dire, idéologiquement, l’extrême-gauche n’existe même plus. Aujourd’hui, les marxistes ne sont plus ni révolutionnaires, ni réformistes, ils sont conservateurs ou réactionnaires. Pour les lecteurs qui, malgré mes articles précédents, ont du mal à concevoir que les marxiste français soient au fond des conservateurs, ils en trouveront un bon exemple dans Le Suicide français d’Eric Zemmour : dans les années 1960 et 1970, de nombreuses banlieues étaient « tenues » par le Parti Communiste français, qui structurait la vie locale et les rapports sociaux comme le faisait l’Eglise à la fin de l’Ancien Régime, et Eric Zemmour regrette ce temps. En France, de nombreux socialo-communistes soi-disant de gauche, tels Gérard Filoche et Jean-Luc Mélenchon, sont animés par les mêmes sentiments. C’est du marxisme, mais c’est conservateur et/ou réactionnaire.
L’extrême-gauche est donc condamnée à se renouveler idéologiquement, car par nature le clivage politique ne peut supporter durablement un déséquilibre.
J’ai déjà dit quelle me semble devoir être la nouvelle idéologie de l’extrême-gauche, puis de la gauche : le libertarianisme et le libéralisme. Cette idéologie devrait s’imposer de la même manière que le socialo-communisme s’est imposé à gauche dans le premier quart du XXe siècle. Je sais que cette affirmation est accueillie avec beaucoup de scepticisme par mes lecteurs, et pourtant de nombreux signes avant-coureurs l’annoncent.
D’abord, se développent en Europe, et spécifiquement en France, des réseaux libéraux inexistants jusque-là. Ils touchent fortement la jeunesse, comme Student for Liberty, qui se déploie dans nos campus. En outre, le libertarianisme a, aujourd’hui, atteint un fort degré de maturité. Une comparaison est frappante : en 1848, Marx et Engels publiaient le Manifeste du Parti communiste et quarante et un ans plus tard, en 1889, se formait au Congrès de Paris l’Internationale socialiste ; en 1973, Murray Rothbard publiait For a New Liberty : The Libertarian Manifesto et quarante-deux ans plus tard, le 7 mars dernier, a été fondé l’International Alliance of Libertarian Parties . La montée en puissance du libéralisme radical est donc tout à fait comparable à celle, il y a un siècle et demi, du socialisme. Dans deux ou trois décennies, en France, le libéralisme pourrait bien être l’idéologie dominante à gauche de l’échiquier politique, tandis que le socialisme se replierait sur la droite, comme le firent jadis le libéralisme, le nationalisme puis l’internationalisme.
La confusion actuelle est le symptôme de la crise du clivage : tant de conservateurs et de réactionnaires qui persistent à se considérer à gauche, tant de libéraux qui s’imaginent encore être à droite. Et cette confusion s’auto-entretient : les gens comme Filoche ou Mélenchon ne sauraient passer à droite, où est la juste place de leurs idées conservatrices, car pour eux la droite est le camp du libéralisme - ce qui est faux, simplement c’est là qu’il se trouvait la dernière fois qu’on l’a aperçu dans le spectre politique ; inversement la plupart des libéraux français se situent à droite, par répulsion pour l’image collectiviste de la gauche - image fausse, puisque socialisme et gauche ne sont pas équivalents, mais il est vrai que depuis un siècle c’est de ce côté que s’est tenu le socialisme. En restant chacun du côté que l’Histoire semble - à tort, j’insiste - lui désigner comme son camp naturel, le progressiste libéral (favorable à la liberté, à la désétatisation du mariage, au libre commerce des drogues) à droite et le conservateur socialiste (voulant préserver le « modèle social » voire l’accentuer un peu) à gauche se repoussent et se maintiennent mutuellement dans le mauvais camp.
Cet équilibre n’est pas stable, car le mouvement de fond, lui, est indiscutable : la France a un régime social démocrate très marqué, au regard duquel les uns sont des révolutionnaires ou des réformistes, les autres des conservateurs ou des réactionnaires. Vraisemblablement, le clivage va achever sa mutation au fur et à mesure que la génération Mélenchon-Filoche disparaîtra et que ces grandes figures cesseront de servir de repoussoirs aux libéraux. En l’absence de ces repoussoirs, qui maintiennent les libéraux à droite, ceux-ci seront expulsés à la place qui est la leur, à la gauche de la droite conservatrice socialiste. Ainsi, la mutation idéologique du spectre politique poursuivra sa marche par le passage des générations ; ce qui converge avec ce qui fut vu au début du XXe siècle, lorsqu'il fallut vingt à trente ans après la proclamation de l'Internationale pour que le socialisme devienne l'idéologie dominante à gauche.
C'est la lutte finale : groupons nous, et demain l'Internationale libertarienne laissera tranquille le genre humain !

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F2%2F1218098.jpg)

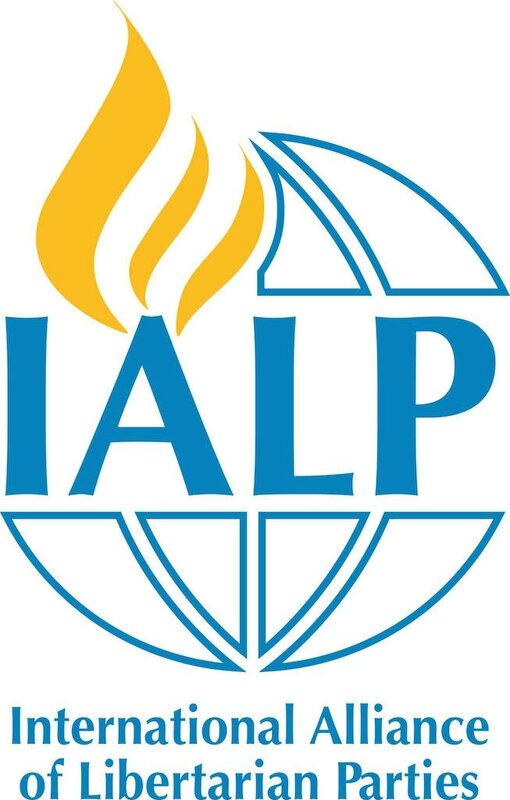


/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F13%2F78%2F1260171%2F107787587_o.png)