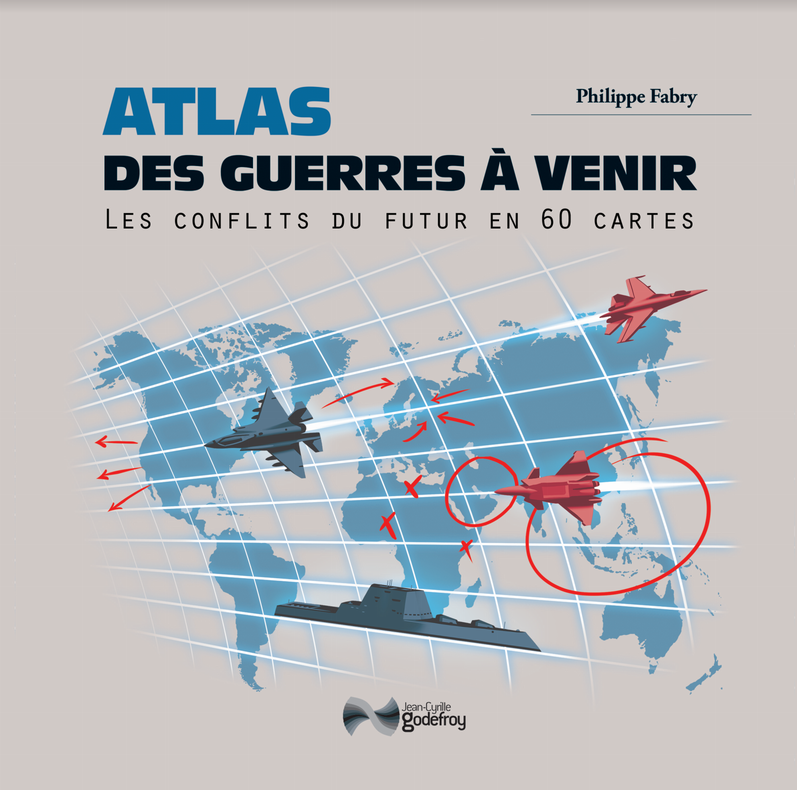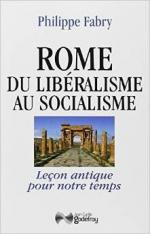Libéral, libertaire ou libertarien ? Ping-pong linguistique et foire d’empoigne sémantique
Il y a quelques jours, j’ai été fort agacé à la lecture d’un article du Figaro, et d'autres articles du même acabit, qui, annonçant la candidature de Rand Paul aux primaires républicaines, qualifièrent celui-ci de « libertaire ». Cette erreur, qui n’était en fait qu’un copié-collé de celle de l’AFP, est persistante malgré l’entrée au Larousse du mot « libertarien ». Et la confusion est pour moi l’occasion de revenir sur le bien-fondé de l’emploi de ce mot de « libertarien », et plus largement d’éclairer sur sa signification ceux de mes lecteurs qui ne la connaîtraient pas déjà.
Il se trouve en effet de nombreux libéraux, en France, pour critiquer l’emploi du mot « libertarien », qu’ils trouvent laid et auxquels ils préfèrent le traditionnel « libéral » ; « libéral » qui, dans son juste sens, traduirait selon eux mieux que « libertarien » le mot anglo-saxon « libertarian ». En plus d’être laid (selon eux) libertarien serait en outre inutile, et donc facteur de confusion, précisément avec le mot libertaire, qui chez nous ne désigne pas les libéraux défendant le respect du droit de propriété, mais des anticapitalistes collectivistes ne s’intéressant qu’à la liberté des mœurs.
C’est un fait connu qu’aux Etats-Unis, « liberal » ne désigne plus, depuis un demi-siècle, des libéraux au sens que ce mot a originellement, mais des sociaux-démocrates. C’est pourquoi les libéraux « traditionnels » américains se sont trouvés, pour se distinguer de leurs homonymes socialisants, le nom de « libertarian » qui est lui-même l’anglicisation du mot français « libertaire ». D’où la confusion médiatique de nos journalistes peu instruits du sujet, car si « libertarian » est une récupération par la langue anglo-saxonne d’un mot français, ce n’est pas une traduction, et le processus n’est donc pas réversible : si l’on traduit, comme cela a été fait au sujet de Rand Paul ou de son père Ron, le « libertarian » en « libertaire », on transforme un libéral en libertaire qu’il n’est pas.
Faudrait-il donc traduire par « libéral » ?
Je vois deux objections à cela : d’abord, ceux qui se qualifient de « libertariens » sont une catégorie particulière de libéraux : il s’agit de radicaux évoluant entre minarchisme et anarcho-capitalisme, et qui rejettent par principe un certain nombre de mesures promues par les libéraux non-libertariens : le contrôle de l’Etat sur la monnaie, la distribution d’un revenu universel ou encore la mise en place du chèque-éducation (liste non exhaustive). Pour les libertariens, tout comme ce fut le cas aux Etats-Unis, le mot « libéral » est de plus en plus usurpé, en France, par des individus qui sont, par rapport à eux, des étatistes. Le fait que ce glissement ne paraisse pas encore définitif laisse espérer à certains libéraux radicaux de pouvoir conserver pour eux le mot de « libéral », et ils récusent par conséquent l’emploi de libertarien qu’ils considèrent comme une capitulation, un abandon du mot « libéral » à des gens qui en trahissent l’héritage. Mais cela me semble une erreur, car le vocabulaire ne fait jamais marche arrière : on n’inverse pas un glissement sémantique. Au mieux, l’on parvient à maintenir, parallèlement à l’usage nouveau, l’usage ancien, mais ce n’est pas une victoire : l’on ne fait alors qu’entretenir une confusion très préjudiciable à la défense de ses idées, qui se trouvent assimilées avec tout un tas d’idées qui n’ont rien à voir.
Ensuite il faut voir que le libertarianisme est un mouvement international dynamique, et en plein essor. Il est parti des Etats-Unis, d’où s’est imposé le terme de « libertarian ». Adopter le terme en le francisant en « libertarien » est le moyen de s’inscrire dans ce grand mouvement. Et comme je l’expliquais récemment, s’opposer à cette francisation au prétexte que l’on disposerait déjà du mot « libéral » n’est pas un argument linguistique convaincant : jusqu’au XIXe siècle, l’on parlait d’aisance, d’agrément, de commodité, quand s’est imposé le mot anglais de « comfort », que l’on a francisé en « confort », lequel est devenu hégémonique dans le langage courant, au point que les autres sont aujourd’hui désuets, et très peu usités. Or, « comfort » venait lui-même du français « conforter », mot qui avait en ancien français le même sens qu’aujourd’hui, à savoir « secourir, aider » ; et en ancien français, le mot de « confort » désignait naturellement le « secours, aide » ; aujourd’hui, on dirait renfort. Il s’agit là du même genre de ping-pong linguistique entre anglais et français qui a accouché de « libertarien ». Et de la même façon que malgré un « confort » signifiant « aisance, bien-être », « conforter » signifie toujours « secourir, aider, renforcer », il ne serait pas aberrant qu’un mot signifiant à l’origine « libertaire » soit employé aujourd’hui, sous une forme légèrement différente, et dans un autre sens.
Ajoutons que, dans ce mouvement « libertarien » international, de nombreux libéraux ne se reconnaissent pas… Et ceux-là sont d’ailleurs hostiles au mot « libertarien ». Par conséquent, le mot en lui-même, jusque dans la contestation de son utilité, distingue effectivement des choses qui ne sont pas équivalentes.
Si l’on doit résumer, donc, tout libéral n’est pas libertarien, mais tout libertarien est un libéral. Et c’est précisément ce qui, malgré la convergence dans certaines idées, interdit de confondre libertaire et libertarien.
Historiquement, entre libéraux et libertaires, il n’est pas question que de positions idéologiques différentes, de préoccupations distinctes : le libéralisme est une philosophie du droit, neutre au plan moral, tandis que l’idéologie libertaire est une morale. Les deux peuvent converger sur certains points, par exemple en disant que l’Etat n’est pas légitime à règlementer le mariage ; mais là où les libertaires clameront que l’amour doit être libre, les libéraux diront que chacun peut avoir sa conception ; idem en matière économique : là où les libertaires promeuvent des économies sous forme de coopératives, ou d’exploitations collectives, les libéraux affirment un unique principe, le respect de la propriété privée, sur la base duquel divers systèmes peuvent être volontairement construits. Bref, les libertaires défendent un ou des modèles d’organisation quand les libéraux défendent la liberté individuelle de choisir un modèle. En d’autres termes, l’idéologie libertaire est un constructivisme, et ce n’est pas un hasard si socialisme et libertarisme sont nés dans le même milieu anarcho-socialiste au XIXe siècle : au fond, le libertarisme est un socialisme.
C’est pourquoi l’expression libéral-libertaire est absurde. Elle vient de la mécompréhension de ses détracteurs qui pensent que le libéralisme est une idéologie se souciant de la liberté économique et le libertarisme une idéologie se souciant de la liberté morale, interprétation erronée liée à une conception tout aussi erronée du clivage gauche-droite.
Un problème important posé par cette association douteuse de libéral-libertaire, et de la confusion de « libertaire » avec « libertarien » est qu’elle détourne du libéralisme radical un grand nombre d’individus attachés à des valeurs morales rejetées par les libertaires : ils s’imaginent que les libertariens, qui refusent la contrainte étatique en matière morale, défendent ce faisant des moeurs libres ; alors qu’en vérité, les libertariens n’en parlent pas : ils sont certes pour la dépénalisation des drogues, pour la désétatisation du mariage, mais ne promeuvent pas pour autant la consommation de drogue ou l’union homosexuelle ; répétons-le : sur le fond de ces questions, le libéralisme est neutre. Et de ce fait, spécifiquement dans sa version radicale, libertarienne, le libéralisme est capable de séduire les partisans de l’amour libre comme les partisans de l’ordre moral, dès lors qu’ils admettent le droit de propriété légitime comme limite naturelle de leurs exigences.
Sauf à être vraiment réticent à l’emploi d’un mot au seul prétexte qu’il viendrait de l’anglais ( la position n’est pas nouvelle : dans l’Antiquité, l’atticisme prétendait défendre la langue grecque, et précisément son dialecte athénien classique, contre l’invasion des mots latins, considérés comme « barbares »), acceptons donc ce « libertarien », qui dit bien ce qu’il veut dire, et désigne ce qu’aucun autre mot ne désigne aussi spécifiquement.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F2%2F1218098.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F97%2F12%2F1260171%2F107939124_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F45%2F46%2F1260171%2F103260641_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F10%2F65%2F1260171%2F103155846_o.png)