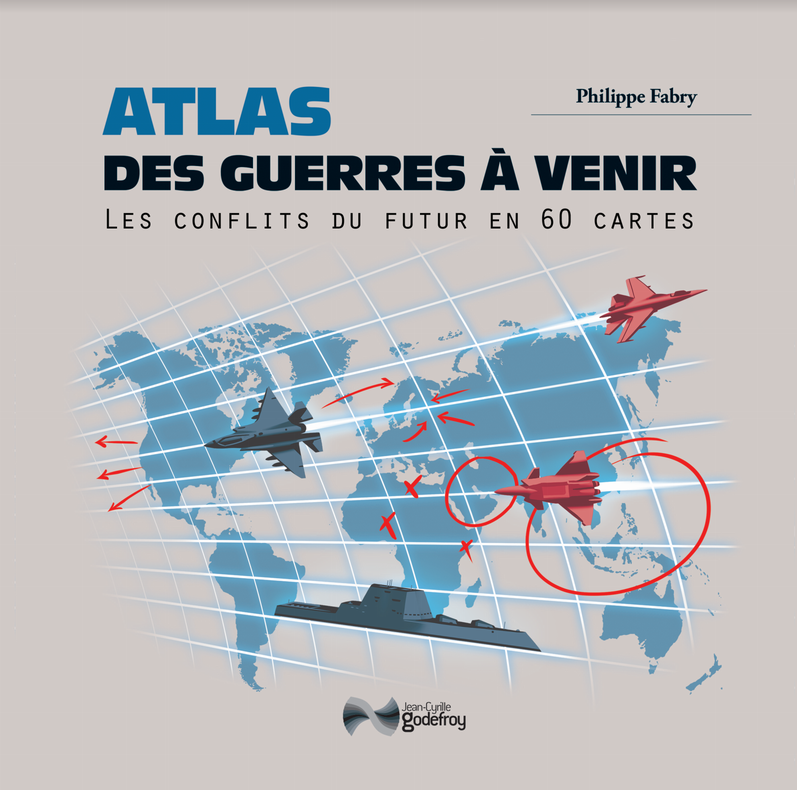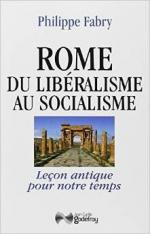ITW Atlantico : Steve Bannon et les droites radicales européennes
1-Au cours de ces derniers mois, l'ex conseiller de Donald Trump, Steve Bannon a multiplié ses efforts pour unifier les partis de "droite populiste et nationaliste" en Europe, au travers de déplacements aussi bien à Rome qu'à Budapest en passant par Londres et Prague. Quelles sont les chances de voir Steve Bannon parvenir à ses fins en Europe ?
Tout dépend ce que l’on appelle « unification ». La présentation que fait Bannon de son objectif n’est pas du tout fantaisiste : ce qu’il cherche, ce n’est pas une unification structurelle, c’est l’unité dans la représentation auprès des instances européennes. Il est en effet convaincu, d’ores et déjà, que les « populistes nationalistes » vont remporter les prochaines élections européennes - et il est vrai que le basculement, tous les six mois, d’un pays européen dans ce « camp » donne à voir une dynamique qui pourrait bien donner un tel résultat. La préoccupation de Bannon est que cette victoire électorale ne soit pas gâchée par les divisions et l’incapacité de se coordonner dans les instances européennes : Bannon sait que les populistes-nationalistes demeureront minoritaites au Parlement européen - il table sur un tiers de parlementaires - mais veut faire en sorte que cette forte minorité soit un bloc, capable de bloquer le fonctionnement des instances européennes, et ainsi de le plier à sa volonté.
On peut bien sûr penser que, par définition, l’unification à une échelle internationale de partis nationalistes est une gageure, puisque le nationalisme semble l’inverse de l’internationalisme. Mais comme je l’explique souvent, les idées politiques se déplacent sur le clivage politique comme sur un tapis roulant : elles apparaissent à gauche et se déplacent vers la droite, jusqu’à disparaître à l’extrêm-droite. Le nationalisme, à l’origine, est une idée de gauche, en France avec la Révolution, bien sûr, mais aussi en Allemagne, ou en Italie. N’oublions pas, par exemple, que la Lega de Salvini, il y a quinze ou vingt ans, militait pour l’indépendance du Nord, c’est-à-dire l’état antérieur à l’unité italienne. Depuis, la Lega est devenu un parti nationaliste à l’échelle du pays, il n’est plus question de partition.
Eh bien l’internationalisme suit le même mouvement : il y a cent ans, l’internationalisme était un concept de gauche, c’était l’internationale ouvrière, socialiste, puis communiste. Aujourd’hui, l’internationalisme reste assez largement une idée de gauche : l’idée d’une gouvernance mondiale s’imposant aux nations, notamment en matière écologique, est portée par des personnalités de gauche. Mais l’internationalisme se répand aussi à droite, et consiste justement en une mise en réseau des nationalismes locaux, qui se reconnaissent dans leurs préoccupations respectives et, surtout, dans l’animosité envers les volontés de gouvernement supranational, par définition moins démocratiques.
Pour revenir à Bannon, donc, il me semble que la dynamique globale des populismes-nationalismes actuels est assez favorable au genre de projet qu’il veut mettre en place, et qu’il y a pour ainsi dire « un coup à jouer ».
2-Quelles sont cependant les limites de l'exercice d'une tentative d'importation en Europe d'une approche américain, reposant notamment sur une opposition du parti de Davos, qui serait incarnée dans le duel entre Georges Soros et Steve Bannon ?
On peut douter, en dépit de la notoriété que lui a donné l’élection de Donald Trump, que Steve Bannon soit un nom qui parle suffisamment aux peuples européens pour lui donner une autorité particulière, mais après tout il ne cherche pas à se présenter, à être candidat à quoi que ce soit, seulement à construire la coordination des partis populistes et nationalistes à l’échelle de l’Europe, et pour cela sa notoriété d’artisan de la victoire de Trump peut être suffisante, au moins dans un premier temps. D’ailleurs, le fait qu’il soit reçu un peu partout par les cadres de ces partis en est un signe. Et au-delà de sa personne, on peut dire que Bannon n’a pas à « importer » d’idées en Europe, elles sont déjà là. Cela fait des années que George Soros est étrillé dans certains cercles et certains médias, comme le symbole de tout ce que détestent les populistes européens : le milliardaire qui a fait fortune dans la finance et utilise cet argent pour promouvoir des idées hostiles aux nations traditionnelles, à leurs frontières, et favorables au multiculturalisme, à l’immigration sans limite. Je pense qu’il n’y a donc pas grand-chose à « importer » de ce côté-là : Bannon vient juste placer son nom en face de celui de Soros, et il peut d’autant plus le faire que Soros lui-même n’est pas un chef politique, mais un coordinateur, un agent d’influence comme lui.
La principale limite est que l’Europe n’est pas les Etats-Unis, d’un point de vue structurel. Rapprocher des nationalistes qui parlent 28 langues différentes et appartiennent non seulement à des Etats, mais à des nations différentes pose beaucoup plus de problèmes qu’organiser le réseau des nationalistes aux Etats-Unis. Cependant, encore une fois, le but de Bannon est moins de construire que de détruire : il veut bloquer et tordre l’Union européenne « de Bruxelles », estimant que le reste se fera de lui-même une fois l’étreinte desserée sur les nations européennes. Et pour cela, le genre de coordination que l’on peut produire entre des nationalistes européens peut éventuellement suffire.
3-Du point de vue des européens, le "Mouvement" créé par Steve Bannon a pu laisser sceptique plusieurs partis qui pouvaient être considérés comme des cibles. Ainsi, l'ex-leader de l'Afd, Alexander Gauland a pu déclarer "Nous ne sommes pas en Amérique" alors que certains pays est-européens, comme la Pologne, jugent négativement la proximité de Steve Bannon avec la Russie. Quels sont ces "écueils", ces particularités de la diversité des partis de "droite populiste et nationaliste" qui entraveraient la réussite du "Mouvement" ?
Oui, c’est précisément ce que je disais à l’instant : l’Europe n’est pas les Etats-Unis, il ne s’agit pas de se promener dans cinquante Etats qui ont la même langue et la même histoire, et qui ne se sont jamais fait la guerre*. L’Europe, c’est deux mille ans de guerre, de nombreux préjugés, une forme persistance de compétition d’une nation à l’autre. Les différences d’intérêts et de culture d’une nation à l’autre sont bien plus fortes ; en fonction de leur positionnement géographique, les différentes nations d’Europe ont toujours tendance à considérer certains pays plutôt avec méfiance ou confiance. La Pologne se méfie de la Russie, mais elle se méfie aussi de l’Allemagne. Il est difficile d’établir un lien fort entre Autrichiens et Hongrois, parce que les seconds conservent un esprit rebelle vis-à-vis des premiers, et les premiers une certaine morgue vis -à-vis des seconds, pour des raisons historiques. Ainsi, Kurz a-t-il appelé à voter pour des sanctions européennes contre la Hongrie de Orban, après avoir adopté un positionnement commun sur l’immigration. Cela a été vécu - et commenté dans les médias nationalistes français notamment - comme une trahison.
Mais il y a aussi le fait, indubitable, qu’historiquement les nationalistes européens sont fréquemment anti-américains, qu’ils reprochent à l’Amérique d’avoir vassaliser l’Europe, et accepter qu’un Américain vienne aujourd’hui coordonner les nationalistes européens serait assez paradoxal.
Mais pas forcément absurde dans la mesure où l’Europe est en effet, largement, devenue une dépendance culturelle de l’Amérique autant qu’elle en est un vassal militaire, et où c’est l’élection américaine de Donald Trump qui a initié l’effet domino nationaliste et populiste.
* A l'exception de la guerre de Sécession, bien entendu, mais on rappellera que celle-ci se nomme en version originale Civil War.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F2%2F1218098.jpg)

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)