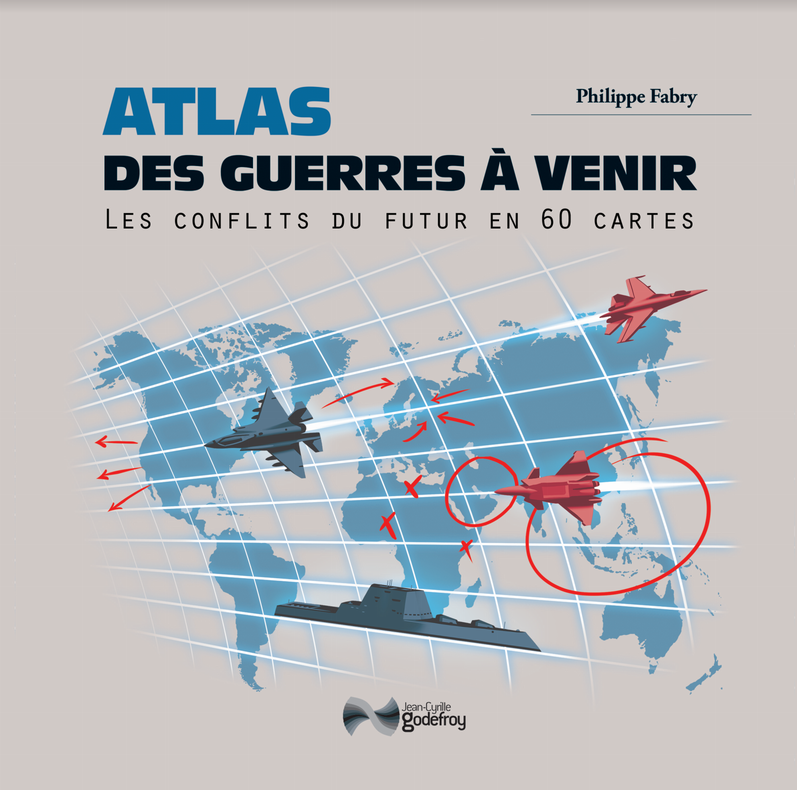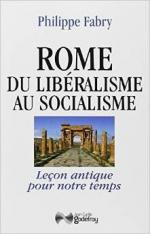La fonction publique : un éternel problème français
Le gouvernement, sans appareil, n'est qu'un mot, mais un bon appareil d’Etat ne coule pas de source : l’exercice de sa mise en place est même très périlleux pour le Pouvoir qui cherche à s’imposer ; la constitution d’un réseau de relais implique une pratique de la délégation qui présente toujours un risque de démembrement de la puissance publique. On peut dire que tout l'histoire de l'Etat, en France spécifiquement, est l’histoire de ce risque.
Depuis sa naissance et à travers ses régimes successifs, le Pouvoir en France a été confronté à la délicate recherche d’équilibre qu’est la création d’une administration à la fois efficace et fidèle. Pour être efficace, ses agents doivent être puissants, et la puissance peut se retourner contre son maître. Pour être fidèles, ses agents doivent être dépendants des gouvernants, mais maintenir des agents puissants dans la dépendance est coûteux.
L'Histoire de France, depuis Clovis, a été marquée par trois grandes étapes d'ascension et de déclin de l'Etat, corrélées à ceux de la fonction publique : la première sous les rois francs mérovingiens et carolingiens, la deuxième sous la monarchie, et la troisième, en cours, sous la République. A chaque fois le souverain, qu'il s'agît des rois francs, des rois de France, puis du peuple français, a été confronté au même problème : la fonction publique créée pour aider ledit souverain à administrer le pays a fini par développer un corporatisme propre, qui a fini par avoir raison du régime.
Permettez-moi de retracer brièvement cette histoire.
D'abord, il y a les Carolingiens. Charlemagne, voulant restaurer l'Empire romain, chercha à créer un véritable Etat franc, en mettant un peu d'ordre dans la tradition politique mérovingienne, où les aristocrates méritants se voyaient confier telle charge publique plus ou moins à l'imitation de celles du Bas Empire romain, charge qui leur permettait souvent de s'enrichir à titre personnel sur le dos de leurs administrés. Par ailleurs, l'armée était alors essentiellement constituée d'hommes libres, et était levée en temps de guerre.
Charles Martel, le père de la dynastie, avait créé une forme d'armée permanente en donnant à des soldats une tenure, une terre censée les entretenir, leur permettre de nourrir un cheval et de se payer un équipement, et en échange de laquelle ils seraient constamment prêt au service, auquel il s'engageaient par serment. Pour cela trouver suffisamment de terres à distribuer, il fallut confisquer quelques biens de l'Eglise.
Charlemagne étendit le système et transforma tous ses aristocrates en fonctionnaires qu'il payait en leur distribuant des terres, dont la propriété lui revenait à leur décès. Leurs fonctions étaient plus encadrées, que sous les mérovingiens, avec l'inspection des services menée par les fameux missi dominici.
Ces institutions permirent une solide reprise en main du territoire et ouvrirent la possibilité, dans un royaume pacifié et administré correctement, avec moins de corruption, de ce que l'on a appelé la "renaissance carolingienne", dans les arts et les lettres.
Mais la situation devait se dégrader : ces fonctionnaires royaux s'habituaient à leurs titre et à leur pouvoir, et cherchèrent un peu plus de sécurité. De leur côté les carolingiens commençaient à manquer de ressources : une fois distribuées les terres, pour maintenir la dépendance et la fidélité des "fonctionnaires" aristocratiques, il fallait continuer à leur en distribuer, et des cadeaux. Naturellement, les rois francs commençaient à manquer de terres. Ne pouvant leur donner plus de terres, la seule option restante était de leur donner plus de droits sur les terres déjà données. Cela arriva en 877, avec le capitulaire de Quierzy, par lequel Charles le Chauve accordait aux aristocrate l'hérédité de leurs charges. Certes, cette possibilité de succession devait encore recevoir l'aval du roi, mais Charles le Chauve mourant peu après, son héritier Louis le Bègue (note : la période mérovingiens-carolingiens est l'âge d'or des surnoms ridicules) dut abandonner l'idée d'un tel contrôle. Dans les décennies qui suivirent le roi perdit ce qu'il lui restait d'autorité sur cette aristocratie, laquelle avait obtenu un statut si sûr qu'elle était devenue complètement autonome, non soumise au pouvoir politique du souverain, devenu inexistant. De cette appropriation de la puissance publique par ce qui avait été le corps des fonctionnaires de Charlemagne naquit la féodalité.
L'on put alors repartir du début.
Par un long travail de reconquête du territoire français, par mariages ou batailles, les rois de France réussirent à revenir sur le devant de la scène. Au mitan du XVe siècle, la couronne de France avait réussi, péniblement, inlassablement, à restaurer l’autorité perdue depuis le règne de Charles le Chauve : en 1445, par l'ordonnance de Louppy-le-Châtel, Charles VII créait les compagnies d'ordonnance, les premières unités militaires professionnelles du royaume ; c'est-à-dire qu'il recréait l'armée permanente, jadis mise sur pied par Charles Martel et utilisée par les carolingiens.
Pour l'administration, cependant, rien n’était réglé : la royauté se trouvait dans la même position que Charlemagne et ses successeurs carolingiens, avec un royaume de grande taille impossible à contrôler sans mettre sur pied un réseau de relais de pouvoir, donc une administration efficace ; administration qui poserait toujours la question de sa fiabilité.
Les rois de France créèrent donc des charges, librement révocables, en confiant par délégation à leurs officiers les prérogatives de puissance publique nécessaires à la mise en œuvre des commandements princiers. Ce faisant ils répétaient la façon de faire des Mérovingiens : les officiers du roi se battirent pour obtenir une plus grande stabilité dans leurs fonctions et celui-ci, ayant besoin de leur soutien pour affirmer son pouvoir, la concéda ; ainsi Louis XI accorda-t-il l’inamovibilité par l’ordonnance de 1467 limitant son intervention dans l’attribution de la charge aux trois cas de décès, démission ou forfaiture. Cette concession fut le point de départ de la vénalité (ou patrimonialité) des charges : tout comme aujourd'hui avec les licences de taxis, les officiers se rendent compte que, puisqu'ils possèdent une charge qui leur rapporte de l'argent et dont ils ne peuvent être démis, cette charge a une valeur économique : se met alors en place le mécanisme de resignatio in favorem, par laquelle un individu transmet son office à un autre, officiellement à titre gratuit, officieusement contre une somme d'argent.
Cette pratique fut d'abord occulte et interdite : un serment fut demandé par Charles VIII aux bénéficiaires de telle transmission par lequels ils affirmeraient n'avoir donné aucun argent. Puis la pratique devint publique lorsque Louis XII comprit qu’il pouvait tirer profit de l’apparition de ce juteux marché : désormais la cession de l'office à titre onéreux serait autorisée, mais soumise à une imposition du quart du prix de vente. Au début du XVIe siècle, les offices étaient des propriétés privées, entrant dans le patrimoine de leur possesseur. La patrimonialité ne deviendrait parfaite qu’avec l’acceptation de l’hérédité, sous Henri IV, en 1604, avec en contrepartie la création de la paulette, taxe d'un soixantième par an de la valeur de la charge.
La dernière étape de cette évolution arriva durant le XVIIe siècle, en particulier sous Louis XIV en raison de ses gros besoins d'argent : désormais le roi vendrait directement les offices qu'ils créerait, souvent à tout propos : la fonction publique royale devenait pléthorique (environ 50 000 officiers sous Louis XV) et largement inutile, certains officiers étant carrément en double, et ne travaillant que la moitié de l'année (on parle d'offices "semestres"). Ces offices permettaient de faire gagner de grosses sommes d'argent au moment de leur vente, mais coûtait de l'argent à l'Etat dans la durée, puisqu'ils ouvraient droit à rémunération.
Là aussi, on s'en doute, les mêmes causes eurent les mêmes effets : les officiers se sentaient largement autonomes, et se permettaient vis-à-vis du roi une attitude contestataire, spécialement les officiers des Parlements, les puissants ancêtres de nos cours d'appel, sans la coopération desquels le roi ne pouvait pas faire appliquer sa législation ( la loi royale n'était applicable dans le ressort d'un parlement qu'une fois enregistrée, c'est-à-dire inscrite dans les registres du parlement ; si les parlementaires refusaient, elle restait lettre morte ; le roi pouvait imposer cet enregistrement, mais la procédure était lourde et, bien sûr, politiquement coûteuse, car les parlementaires avaient développé, au niveau du pays entier, un fort corporatisme nommé théorie des classes).
Ces parlements, donc, avaient le pouvoir de bloquer toute réforme d'ampleur du royaume, notamment en matière de fiscalité. La monarchie essaya de les briser avec la réforme Maupeou de 1771, qui abolit la vénalité des offices, et créa un corps de fonctionnaires de justice de remplacement. Mais Louis XVI, influencé par Maurepas, renvoya Maupeou en 1774 et restaura les Parlements dans leur état antérieur ; leur opposition aux réformes reprit aussitôt, de plus belle, entraînant un blocage qui conduisit à la convocation des Etats-généraux, à la Révolution et à la liquidation de l'Ancien Régime. Maupeou aurait dit « J'avais fait gagner au roi un procès de trois siècles. Il veut le reperdre, il est bien le maître. » En effet, c'était bien un procès de trois siècles, tout comme d'ailleurs le procès des premiers mérovingiens à Louis le Bègue avait duré trois siècles.
C'était il y a un peu moins de trois siècles.
A la Révolution, tout a sauté... mais comme on ne pouvait pas se passer de fonction publique, il a bien fallu recommencer à en créer une.
Durant tout le XIXe siècle, on devait rester sur un effectif limité : l'on tournait autour de 500 000 employés publics pour une population comptant entre 35 et 40 millions de personnes. Un effectif gonflé par rapport à l'Ancien Régime, mais des fonctionnaires n'ayant ni la sécurité de l'emploi, ni le droit de grève, ce qui conférait une certaine souplesse dans l'emploi de cette fonction publique.
Cependant, les mêmes travers que par le passé ont fini par se faire sentir, et à la Libération, apparut le statut général de la fonction publique (remplaçant celui de Vichy), par lequel les fonctionnaires français obtenaient la sécurité de l'emploi, une inamovibilité dans des conditions proches de celles octroyées par Louis XI en 1467. Depuis, les effectifs de la fonction publique se sont multipliés, puisque l'on est rendu aujourd'hui à plus de cinq millions de postes à temps plein. Côté hérédité, on progresse puisqu'il est d'ores et déjà évident qu'il est plus facile d'être fonctionnaire quand on est fils de fonctionnaires, ou qu'on a déjà de la famille dedans, le piston étant particulièrement de mise dans la fonction publique territoriale, aux modalités de recrutement plus "souples" que la fonction publique d'Etat ; certaines modalités d'embauche sont même ubuesques, sans pour autant supprimer le concours qui donne l'alibi de l'impartialité, et débouche sur ce curieux phénomène des reçus-collés.
Ces emplois ne sont pas encore devenus héréditaires, quoique l'on puisse presque dire le contraire au sujet de la haute fonction publique endogamique. En tout cas, depuis des décennies, la fonction publique est bien devenue une force de blocage dans la réforme du pays, à coups de grèves et de manifestations que le statut protégé permet de pratiquer tout son saoûl. Et cette impossibilité de réformes guide le pays vers de très sombres perspectives électorales.
Alors, après les rois francs, après les rois de France, la fonction publique aura-t-elle la peau de la République ?

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F2%2F1218098.jpg)





/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F43%2F70%2F1260171%2F122551344_o.png)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F56%2F1260171%2F122489832_o.png)
/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)