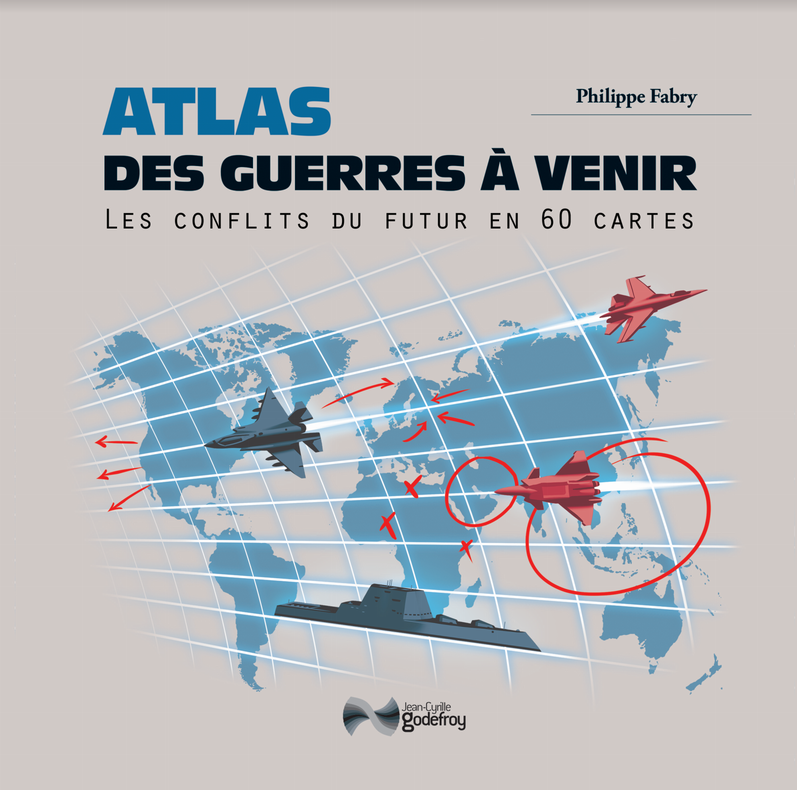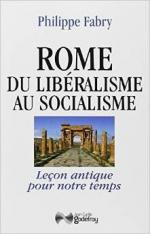Historicité des mythes grecs 2/3 : la Guerre de Troie
En attendant la publication, courant de semaine prochaine, de deux billets que j'espère avoir le temps de mettre en forme consacrés à l'élection présidentielle américaine et à un point sur la situation en Syrie et au Moyen orient, j'ai décidé de vous livrer ce week-end, découpé en trois billets, un extrait d'une dizaine de pages de mon livre Histoire du Siècle à venir (cf. les liens ci-contre à droite, notamment pour ceux qui recherchent la version électronique du livre) dans lequel je m'intéresse à l'histoire de l'empire mycénien, dont je m'attache à retracer l'histoire en croisant les sources mythiques et archéologiques, en soulignant leurs nombreux points de concordance. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager si vous trouvez cela intéressant.
Aujourd'hui, deuxième partie de l'extrait (le premier est ici) consacré à l'historicité de la guerre de Troie et à une hypothèse sur l'identité des énigmatiques Peuples de la Mer...
C’est à une époque contemporaine de Thésée, où les Achéens affirment leur indépendance vis-à-vis de la Crète et renversent le rapport de vassalité, que les gestes héroïques de la tradition grecque donnent aussi témoignage d’un expansionnisme mycénien naissant, avec le voyage des Argonautes en Colchide, et surtout les aventures d’Héraclès.
Celui-ci est aux ordres d’Eurysthée, roi de Mycènes, qui lui impose ses fameux douze travaux. Cet amusant duo du héros invincible et de son maître lâche et cruel paraît l’exagération satirique de l’association d’un dirigeant mycénien peu enclin à la guerre lui-même mais ayant disposé d’un parent (Héraclès est le cousin d’Eurysthée) qui se serait montré un général énergique, et finalement plus digne d’un titre de roi. Ainsi, suivant sa légende, Héraclès s’occupe-t-il de nettoyer toute la Grèce de ses bêtes féroces et de ses brigands sur l’ordre d’Eurysthée, avant de s’embarquer pour Troie où il mène une première guerre victorieuse, deux générations avant celle d’Achille, d’Agamemnon et de Ménélas. Ce récit légendaire mérite d’être pris au sérieux quant à son idée générale car les textes hittites, pour la période donnée par Hérodote pour les exploits d’Héraclès, vers 1400 avant notre ère, attestent d’un affrontement armé entre un certain Attarsiya, homme des Ahhiyawa, ayant chassé de sa terre de Wilusa un individu appelé Madduwatta, vassal des hittites. Pour les archéologues, il est de plus en plus probable que le royaume d’Ahhiyawa des textes hittites soit la nation achéenne (Achaioi, chez Homère), et que Wilusa soit la transposition hittite du grec archaïque Wilios, devenu Ilios en grec classique, c’est-à-dire Ilion, la ville de Troie. Pour les archéologues et les connaisseurs de la mythologie héroïque, le nom hittite d’Attarsiya évoque fortement Atrée, en grec Atreus, successeur d’Eurysthée sur le trône de Mycènes, dont Héraclès était un agent. Dès ce début de XIVe siècle, donc, tradition héroïque grecque et recherches archéologiques s’accordent sur un expansionnisme mycénien en direction de Troie, par lequel les Achéens se heurtent une première fois au puissant empire hittite, le plus grand empire de l’époque avec l’empire égyptien. Et l’affrontement est à l’avantage de la jeune puissance mycénienne, qui voyait probablement en Troie un dangereux balcon hittite sur l’Egée, la ville ayant été, selon les annales hittites, intégrée à leur empire sous le règne de Tuthaliya Ier (mort vers 1430 avant notre ère)[4].
Ce premier conflit, tout comme la principale guerre de Troie, qui se déroule suivant Hérodote un siècle après les aventures d’Héraclès, paraît s’inscrire dans une lutte séculaire entre achéens et hittites s’achevant finalement par la destruction pure et simple de l’empire de ces derniers ; il est plausible que le récit homérique, qui donne au conflit une durée déjà épique de dix ans, comprime en réalité une succession de faits de guerre s’étalant sur plusieurs décennies. Un document diplomatique retrouvé dans la capitale hittite, la grande cité d’Hattusa, évoque un affrontement vers 1280 avant notre ère, c’est-à-dire environ un siècle après l’attaque d’Attarsiya - soit le même intervalle que celui donné par Hérodote et la tradition héroïque - et l’on a trouvé un traité entre l’empire hittite et Alaksandu, roi de Wilusa (identifié à l’Alexandre homérique, c’est-à-dire Pâris, fils de Priam, roi de Troie) évoquant un soutien militaire accordé à Troie par les hittites dans un conflit récent.
Un autre document hittite, la « lettre de Tawagalawa », datant des alentours de 1250, est adressé par un souverain hittite, que l’on estime être Hattusili III, au « Grand roi d’Ahhiyawa ». Le nom de ce dernier n’apparaît pas sur la tablette hittite, mais le titre de « Grand roi » implique que le souverain hittite reconnaissait à son interlocuteur un statut équivalent au sien, et donc la puissance d’Ahhiyawa. Hattusili mentionne dans cette missive un récent conflit entre Achéens et Hittites à propos de Wilusa et demande au Grand roi achéen l’extradition d’un personnage, Piyama-Radu, considéré comme un bandit et fauteur de troubles. On a pu voir dans le nom de ce personnage celui de Priam, roi de Troie[5], mais après l’assimilation Alaksandu/Alexandre, cela ne correspond pas à l’ordre chronologique du récit homérique. Toutefois, si la tradition a pu mélanger les noms et leur donner un nouvel ordre, la trame profonde des faits, à savoir la confrontation géopolitique des Achéens et des Hittites, est une fois de plus attestée.
En l’état actuel des connaissances archéologiques, il n’est plus fait mention d’Ahhiyawa dans les archives hittites après cette date des environs de 1250 avant J.-C. Mais il faut dire que l’empire hittite lui-même disparaît complètement vers 1200 avant notre ère, du fait, selon les sources égyptiennes, des énigmatiques « Peuples de la Mer ».
Ces Peuples de la Mer sont des envahisseurs appartenant à des ethnies diverses et ayant attaqué l’Egypte à deux reprises : une première fois autour de 1200, sous le règne du pharaon Merneptah, et une deuxième fois en 1177 sous le règne de Ramses III. La première fois, ils arrivèrent par la Libye, alliés au libyen Meryey, et la deuxième fois par la Syrie après avoir détruit l’empire hittite.
La première vague était suivant les sources égyptiennes et l’interprétation des archéologues composée des Ekwesh (Achéens), des Teresh (soit des Etrusques de Lydie, soit des hommes de Tarse ; en tout cas des Anatoliens), des Lukka (de Lycie, dans la péninsule anatolienne), des Sherden (soit des Sardes, de Sardaigne, soit des Anatoliens de Sardis, en Lydie) et des Shekelesh (soit des Sicules, de Sicile, soit des Anatoliens de Sagalassos) ; en résumé, essentiellement des Achéens et des Anatoliens, ces derniers étant d’anciens vassaux de l’empire hittite.
La deuxième vague comprenait des Peleset (Pélasges ou Philistins, originaires de Crète ou aborigènes de Grèce, avant l’arrivée des Achéens), des Tjeker (probablement des Thraces), des Weshesh (originaires soit de Wilusa/Troie, soit d’Issos, dans l’un ou l’autre cas des Anatoliens), des Denyen ou Danouna (ce qui pourrait désigner les Danaéens, qui est un autre nom qu’Homère donne aux Grecs - Danaioi - donc aux Achéens)[6], et encore une fois des Shekelesh.
Le seul consensus qui semble émerger entre les historiens quant aux Peuples de la Mer est leur origine largement égéenne. Leur rôle exact dans les bouleversements de la fin de l’Âge du Bronze récent est discuté : on se demande s’ils sont responsables de la disparition de l’empire mycénien, s’ils ont réellement détruit l’empire hittite ou s’ils ont profité de son effondrement interne.
L’hypothèse qui nous paraît la plus probable, et qui semble pourtant peu évoquée dans les débats historiographiques, est que ces Peuples de la Mer n’étaient pas seulement des migrants envahisseurs, mais des coalitions rassemblées par les Mycéniens dans un but de conquête. Cela ne serait pas surprenant de la part d’une nouvelle puissance fortement hégémonique que de cesser de partir en guerre seule. Près de deux mille ans plus tard, lors de la campagne de Perse de l’empereur romain Julien l’Apostat, c’est à une armée composée de légions romaines peuplées de Gaulois, ainsi probablement que de Syriens et d’Anatoliens, alliées aux arméniens du roi Arsacès, que les Perses furent confrontés. L’hypothèse d’un semblable modus operandi de la part des Mycéniens n’est pas à écarter, et des éléments penchent en son sens.
Tout d’abord, au plan archéologique, nous avons vu que dans chacune des attaques les sources égyptiennes évoquent la présence de Grecs : d’une manière à peu près certaine avec les Ekwesh de la première vague, un peu plus hypothétique avec les Denyen de la deuxième vague. Dans le décompte des pertes ennemies donné par les inscriptions égyptiennes au sujet de la première invasion, on trouve 6359 Libyens, 222 Shekelesh, 742 Teresh, 2201 Ekwesh, 200 Lukka et Sherden[7] ; autrement dit, en admettant que ces pertes soient proportionnelles aux effectifs engagés, pour l’essentiel les troupes étaient libyennes, mais parmi les Peuples de la Mer plus des deux tiers étaient des Achéens. Le fait que les Achéens aient constitué, au départ tout au moins, la plus grande partie de l’effectif des Peuples de la Mer rend douteux que ceux-ci puissent être tenus pour responsables de la disparition de l’empire mycénien, et tout aussi douteux que la disparition de l’empire mycénien ait pu provoquer ces mouvements de population : les Achéens étant à ce moment visiblement nombreux et suffisamment aptes au combat pour monter une expédition en Egypte, on voit mal ce qui aurait pu les chasser de leurs propres terres. De surcroît le fait que, outre les Achéens, l’essentiel des Peuples de la Mer ait été constitué d’Anatoliens, pour la plupart anciens vassaux de l’empire hittite, lequel a disparu après une lutte séculaire avec la nation mycénienne, laisse à penser que ces peuples sont tout bonnement passés sous suzeraineté mycénienne après l’effondrement hittite, et cela que cet effondrement fût le fait d’une conquête mycénienne directe ou résulte simplement de causes internes auxquelles s’ajoutait la pression achéenne. Aussi bien a-t-on des traces plus anciennes d’alliance des Achéens avec des vassaux hittites contre les hittites eux-mêmes, dans l’expédition d’Attarsiya à Chypre avec l’aide de Madduwata (qu’il avait vaincu et dont il a été question plus haut) et des Lukka, qui comptent précisément parmi les Peuples de la Mer de la première vague[8].
Autre élément important, le témoignage égyptien lui-même suggère non l’invasion chaotique de peuples barbares mis en mouvement par une sorte d’effondrement systémique frappant tout l’ancien Orient, mais bien des plans concertés. C’est évidemment le cas pour la première coalition rassemblée au côté du libyen Meryey, mais plus encore dans le témoignage de Ramsès III inscrit sur les murs du temple de Médinet Habou, situé en Haute-Egypte : « Les pays étrangers firent une conspiration dans leurs îles. Tous les pays furent sur le champ frappés et dispersés dans la mêlée. Aucun pays n'avait pu se maintenir devant leurs (les Peuples de la Mer) bras, depuis le Hatti, Karkemish, Arzawa et Alashiya. Ils ont établi leur camp en un lieu unique, le pays d'Amurru, (…) L'ensemble (de ces peuples) comprenait les Peleset, les Tjeker, les Shekelesh, les Denyen et les Weshesh. Tous ces pays étaient unis, leurs mains (étaient) sur les pays jusqu'au cercle de la terre, leurs cœurs étaient confiants et assurés : « Nos desseins réussiront ! »[9]. Est bien ici évoquée une coalition organisée, une expédition planifiée, lancée depuis un empire régnant sur un espace gigantesque, encerclant l’Egypte. De fait, si l’empire mycénien s’était étendu brièvement sur les anciennes possessions hittites, alors il comprenait la Grèce, la Crète et la mer Egée, l’Anatolie, Chypre, la côte syrienne et le Liban, soit une superficie trois fois supérieure à l’empire égyptien, et toute la partie du monde méditerranéen connu des égyptiens, hors la Libye. Jamais l’Egypte n’avait connu un adversaire si formidable et, outre l’importance pour Ramsès de magnifier dans ses inscriptions la force de l’ennemi pour souligner sa propre gloire, on imagine le danger qui planait sur le vieil empire et le caractère inédit de ce nouvel adversaire : après sa victoire totale sur l’adversaire hittite, l’empire mycénien était une hyperpuissance, comme Rome à la chute de Carthage et les Etats-Unis à la chute de l’URSS.
La principale objection qui peut être soulevée, au vu des données archéologiques, est qu’à la même époque de la destruction de l’empire hittite et des attaques des « peuples de la mer » relatées par les sources égyptiennes, on observe une vague de destruction en Grèce continentale, cœur de la puissance mycénienne, ce qui soulève cette question : pourquoi les Mycéniens auraient-ils monté des expéditions si ambitieuses et si loin de chez eux alors que leurs terres étaient assaillies, ou à tout le moins subissaient de terribles destructions ? Il y a plusieurs problèmes avec les données archéologiques ; d’abord les dates sont trop imprécises pour connaître exactement l’ordre des événements : les Grecs peuvent être partis et une invasion s’être déroulée en leur absence, tout cela en quelques mois. L’autre problème est dans l’interprétation des destructions : il peut aussi s’agir d’un conflit « domestique », une sorte de guerre civile entre achéens, hypothèse qui a notre préférence et sur laquelle nous reviendrons. Enfin, il faut voir que des destructions sur le propre territoire achéen ne signifie pas une mort subite et une incapacité à monter des expéditions d’envergure : par analogie une étude archéologique et documentaire des Gaules au IVe siècle de notre ère montre évidemment des destructions massives, à la fois le fait d’envahisseurs germains et de bagaudes, des autochtones devenus bandits et en rébellion contre l’Empire romain, et pour autant cela n’empêcha pas Julien de monter la campagne de Perse évoquée plus haut, pour laquelle il rassembla l’effectif colossal de 90 000 hommes environ. Un conflit domestique, qu’il soit d’origine interne ou externe, n’est donc pas une objection définitive à l’interprétation des expéditions des Peuples de la mer comme des campagnes orchestrées et conduites par les Achéens.
Et surtout, une fois de plus, la tradition héroïque nous donne une histoire pour interpréter les informations de l’archéologie.
On trouve ainsi dans les récits d’Hérodote un fort indice du fait que les Peuples de la Mer fut une coalition autour des Achéens. L’historien grec affirme avoir questionné des prêtres égyptiens sur la réalité de la guerre de Troie et que ceux-ci tenaient ce qu’ils en savaient de Ménélas, roi de Sparte et frère d’Agamemnon, qui se serait rendu en Egypte pour y chercher Hélène à la fin de la guerre et aurait procédé à des saccages dans ce pays, avant de s’enfuir par la Libye. L’Odyssée en ses livres III et IV, de même qu’Apollodore[10] donne d’autres éléments sur le voyage de Ménélas, qui quitte Troie après la victoire alors qu’Agamemnon y demeure avec la moitié de l’armée achéenne. Ménélas s’aventure non seulement en Egypte et en Libye, mais à Chypre, en Phénicie, à Sidon, chez les Erembes (probablement les Arabes) et en Ethiopie. A l’exception de cette dernière, et quoi qu’elle soit proche de l’Egypte, les étapes ainsi attribuées par Homère à Ménélas correspondent aux zones touchées par les invasions des Peuples de la Mer : Chypre, Syrie, Liban, Canaan. L’époque, en revanche, ne correspond pas exactement, puisqu’à suivre la chronologie d’Hérodote la guerre de Troie a lieu autour de 1250, ce que semblent confirmer les sources hittites, quand les deux vagues d’attaques des Peuples de la Mer en Egypte datent d’un demi-siècle et de trois quarts de siècle plus tard. Là encore, la légende a pu comprimer des faits plus étendus dans le temps, mais on ne comprend alors pas pourquoi la chronologie d’Hérodote, basée sur la tradition héroïque, semble parfaitement correspondre aux données tirées des archives hittites pour une période plus ancienne. Cela expliquerait pourquoi Eratosthène, qui donne généralement des dates correctes au regard de l’archéologie, date la chute de Troie de 1183 avant notre ère, à peine six ans avant l’attaque massive sur l’Egypte de Ramses III : peut-être la date qu’il donne n’est pas celle de la chute de Troie, mais celle de la chute d’Hattusa, ravagée par les Mycéniens alliés aux anciens vassaux des Hittites après avoir vaincu à Troie. On aurait ainsi Hérodote qui donnerait la bonne date pour le début de la confrontation séculaire entre Achéens et Hittites, et Eratosthène la bonne date pour la fin de ce long conflit.
Les errances de Ménélas ne sont pas la seule trace d’expéditions militaires mycéniennes jusqu’en Egypte, on en trouve aussi l’écho dans le récit qu’Ulysse livre au quatorzième chant de l’Odyssée, : « Là-bas, neuf années durant, nous, les fils des Achéens, nous fîmes la guerre. Au cours de la dixième, après avoir mis à sac la ville de Priam, nous nous embarquâmes à bord de nos vaisseaux pour retourner chez nous. [...] Mon cœur alors me poussa à naviguer dans l'Égyptos, après avoir, avec l'aide de divins compagnons, soigneusement équipé des vaisseaux. J'armai neuf navires, et foule de marins promptement accoururent. [...] Nous atteignîmes en cinq jours ! Égyptos au beau cours, et je mouillai dans les eaux de ce fleuve nos vaisseaux roulant d'un bord à l'autre. Parvenu là, j'ordonnai à mes fidèles compagnons de rester auprès de leurs navires et de garder les nefs, et j'envoyai des observateurs sur les points culminants. Mes gens alors, cédant à leur violence, et se laissant guider par leur envie, se mirent aussitôt à ravager les riantes campagnes de ce peuple d'Égypte, à emmener les femmes et les petits enfants, à massacrer les hommes. Le cri du combat parvint vite à la ville. Les Égyptiens entendant ces clameurs, arrivèrent au moment où l'aube apparaissait. Toute la plaine était remplie de fantassins, de conducteurs de chars et des éclairs du bronze. Zeus lance-foudre déchaîna sur nos gens une funeste panique ; nul n'osait tenir et faire face, car de toutes parts le malheur les forçait. Les Égyptiens alors tuèrent nombre des nôtres avec le bronze aigu, et emmenèrent les vivants pour les contraindre à travailler pour eux. [...] Aussitôt, je dépouillai ma tête de son casque bien fait, j'enlevai le bouclier que j'avais aux épaules, et ma main rejeta sa lance loin de moi. Alors, avançant tout droit vers les chevaux du roi, je saisis ses genoux et je les embrassai. Il me protégea et me prit en pitié ; puis, m'ayant fait asseoir sur son char, il me conduisit tout baigné de larmes jusque dans son palais. A la vérité, foule de ses sujets s'élançaient sur moi avec leurs lances de frêne, brûlant de me tuer, car leur fureur se trouvait à son comble. »[11] Ce témoignage est probablement le résultat de l’intégration à la tradition héroïque de récits de survivants de l’expédition contre l’Egypte de Ramsès III, faits un temps prisonnier des Egyptiens ; comme dans le périple de Ménélas c’est une incursion violente en Egypte s’achevant par un échec qui est montrée ici.
Au total, le scénario historique mycénien semble être le suivant : peu avant 1200 avant notre ère, au terme d’une série de conflits contre les Hittites ayant débuté autour de Troie durant près d’un siècle, les Achéens triomphent de l’empire hittite, qui s’effondre, en occupent les possessions et en soumettent les vassaux. Les Achéens, forts de nouveaux alliés, débarrassés d’un ennemi très puissant et probablement enhardis par une victoire suffisamment historique pour être chantée durant mille ans, préparent de nouvelles expéditions pour soumettre la riche Egypte comme ils ont terrassé les Hittites. Pour leur première expédition, ils s’allient au roi de Libye mais sont repoussés par les troupes de Merneptah. Une génération plus tard, les Achéens rassemblent leurs vassaux et partent d’Anatolie vers l’Egypte en passant par la Syrie, s’emparant de Chypre (Alashiya, pour les Egyptiens). Une nouvelle fois, l’invasion échoue et l’Egypte les repousse, mais les Achéens et leurs alliés parviennent à conquérir Canaan où s’installent comme colons les Pélasges, qui y resteront célèbres sous le nom biblique de Philistins, ainsi que des Anatoliens (Sherden) et des Thraces.
Retrouvez la suite ici.
[4] Dans ces documents hittites le souverain raconte qu’il a conquis vingt-deux pays dont Taruisa et Wilusa, où l’on retrouve les deux noms de Troie et Ilion.
[5] S.P. Morris, "A Tale of Two Cities", American Journal of Archaeology, 93,1989, p. 532.
[6] Pour la reprise du terme Danaioi par les égyptiens, on a aussi évoqué le terme Tanaju, apparaissant dans les annales de Thoutmosis III, au XVe siècle avant notre ère, et dans le temple mortuaire d’Amenhotep III, au XIVe siècle avant notre ère.
[7] Robert Drews, The End of the Bronze Age: Changes in Warfare and the Catastrophe Ca. 1200 B.C, Princeton, 1996, p . 49 où il donne comme décompte des pertes ennemies : 6359 libyens, 222 Shekelesh, 742 Tursha, 2201 Ekwesh, 200 Lukka et Shardana.
[8] Trevor Bryce, The Kingdom of the Hittites, Oxford, 1999, p. 147.
[9] J’ai repris la traduction proposée à http://www.archeostudio.net/44.html
[10] Épitomé, VI, 29-30.
[11] Traduction de Mario Meunier, 1943, http://iliadeodyssee.texte.free.fr/aatexte/meunier/odysmeunier/odysmeunier14/odyssmeunier14.htm

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F2%2F1218098.jpg)



/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F38%2F32%2F1260171%2F114375486_o.png)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F25%2F90%2F1260171%2F110174268_o.png)
/http%3A%2F%2Fcreationwiki.org%2Fpool%2Fimages%2Fthumb%2Fd%2Fdc%2FReligiousSymbols.JPG%2F250px-ReligiousSymbols.JPG)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F23%2F36%2F1260171%2F109475751_o.jpg)