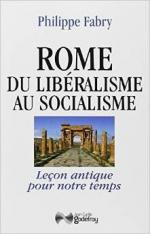VIDEO : Chaos dans le monde arabe : l'Occident responsable ?
Comme d'habitude, ci-dessous le texte de la vidéo
La Mécanique de l'Histoire 2 Chaos dans le monde arabe : L'Occident responsable ?
Aujourd’hui, et dans le prolongement de la précédente vidéo consacrée au Printemps arabe, nous allons revenir sur la situation chaotique dans une partie du monde arabo-musulman, et évoquer la question très à la mode de la responsabilité occidentale.
Depuis les attentats perpétrés le 13 novembre 2015, l’on voit des gens comme Michel Onfray, mais aussi Tariq Ramadan, qui expliquent que nous sommes victimes du terrorisme à cause de nos interventions à l’extérieur. Cet argument est également repris par les partisans de la thèse du Blowback, le retour de flamme, souvent évoquée par l’homme politique américain Ron Paul. L’idée est que les interventions militaires à l’extérieur, même avec de bonnes intentions, entrainent des réactions néfastes contre ceux qui interviennent.
Ainsi, de nombreuses productions diverses tournent sur les réseaux sociaux et qui font de l’Occident en général et des Etats-Unis en particulier, les responsables directs de la situation du monde arabe.
Ce sont les Européens et les Américains qui auraient fait sombrer des pays comme la Libye, la Syrie, l’Irak dans le chaos.
Je vais ici contester ces thèses. Non pas que j’ai envie de défendre des interventions militaires que je juge en général inutiles et coûteuses, mais en tant qu’historien et théoricien de l’Histoire j’ai le goût des causalités bien déterminées.
Or, le discours qui fait des interventions militaires occidentales dans le monde musulman la cause sinon exclusive, du moins principale du terrorisme est un exemple de fausse logique, d’argument « post hoc ergo propter hoc », qui prétend dire que ceci est la cause de cela simplement parce que chronologiquement ceci précède cela.
Mais le meilleur moyen de réfuter cette position est de pointer les vraies causes du chaos dans le monde arabe. Et c’est ce que je voudrais faire à présent.
Dans ma précédente vidéo, j’ai déjà expliqué en quoi le stade global d’évolution pluriséculaire des sociétés arabo-musulmane était propice à un mouvement de révolutions en cascade comme le Printemps arabe. C’était là ce que l’on peut appeler la cause générale. Essayons à présent de discerner les causes spéciales, c’est-à-dire les éléments déclencheurs et le tenseurs de cette crise.
Voyons d’abord ce que j’appelle les tenseurs, soit les forces contraires qui produisent la crise.
Avec la décolonisation, le monde arabe est entré dans l’ère politique, c’est-à-dire le moment où la majorité de la population devient politiquement polarisée, attachée à un « camp » politique. En Europe, c’est le déclenchement de la Revolution française et la destruction d’anciennes structures de pouvoir par les armées révolutionnaires et napoléoniennes qui avait provoqué ce basculement.
Dans le monde arabe, donc, c’est le retrait des administrations occidentales avec la décolonisation qui a laissé le champ libre à la politisation de la société. Aussitôt sont apparus, même si leurs racines idéologiques sont plus anciennes, deux courants représentant en réalité deux réactions distinctes à ce que j’appellerai la « modernité », c’est-à-dire un ordre politique et social rompant avec les structures et les solidarités traditionnelles, associé à un mode de vie de plus en plus urbain et de moins en moins rural, marqué par un repli du religieux vers la sphère privée, une forte sécularisation de la société et une acceptation de l’hétérogénéité religieuse. La première réaction tendait à l’adoption de la modernité, la seconde à son rejet.
La première réaction s’est incarnée dans le nationalisme arabe, la deuxième dans le salafisme.
Le nationalisme arabe est assez comparable à ce que l’on avait jadis observé en Europe, notamment avec le jacobinisme de la Révolution française : il s’agissait de fondre tous les Arabes dans une unique République, et de libérer les populations des pays arabes « par le haut », c’est-à-dire par l’exercice d’un pouvoir central qui se voulait émancipateur. Pour cela il faudrait, d’autorité, imposer une citoyenneté unique permettant de supprimer les distinctions sociales traditionnelles.
En particulier, tout comme cela avait été le cas en Europe, ce projet de citoyenneté unique dans une société sécularisée était perçu comme la solution aux querelles de religion, c’est pourquoi l’on trouvait beaucoup d’arabes chrétiens parmi les partisans du nationalisme arabe.
L’autre réaction à la modernité, c’est une réaction de rejet avec le salafisme, prônant non pas l’adaptation à la modernité, mais un retour à l’islam du passé.
Le salafisme moderne, apparu au XVIIIe siècle et prenant son essor au XIXe, devient un véritable mouvement politique au XXe siècle, spécifiquement avec la fondation, en 1928, des Frères Musulmans, mouvement politique opposant au panarabisme du nationalisme arabe laïc une ambition panislamiste, et proposant comme alternative à la modernité un retour à un islam des origines que le principal théoricien du mouvement révolutionnaire, Sayyid Qutb, estimait ignoré par la plupart des musulmans.
Le salafisme est l’équivalent des mouvements européens hostiles à la modernité qui, du babouvisme au nazisme en passant par le bolchévisme et le fascisme, ont réagi à la révolution industrielle et à la disparition des anciennes structures sociales par le rêve du retour à une société « d’ouvriers et de paysans ».
Les deux mouvements sont donc, dès le début, fondamentalement opposés, et les Frères musulmans ou partis de la même mouvance seront réprimé continuellement par les régimes autoritaires laïcs.
En effet, le mouvement nationaliste, s’il intègre les idées modernes de laïcité, d’abandon des structures sociales traditionnelles et de libération des individus par la citoyenneté, demeure autoritaire et ne permet pas la transition démocratique, comme c’est souvent le cas dans les révolutions nationales : dans la plupart des grands pays européens, la démocratie ne s’est pas imposée à la première révolution, mais seulement après que les camps nés de la révolution se soient assez affrontés pour comprendre la nécessité du compromis démocratique.
C’est ce que l’on peut appeler la maturité politique : les structures sociales et le niveau d’instruction de la population ne permettaient pas encore cette mutation dans le monde arabe.
Donc, les régimes nationalistes arabes n’ont pas permis l’alternance démocratique.
Et cela d’autant moins que, en dépit du vernis « nationaliste » et laïc, des considérations ethnico-religieuses dicteront les termes des luttes de pouvoir au sein de ces régimes autoritaires dont la population est moins homogène ; ainsi, en Irak et en Syrie, observe-t-on, sous le règne du parti nationaliste arabe Baas des Assad et de Saddam Hussein, une installation au pouvoir des minorités musulmanes, dans des proportions inverses : un pouvoir sunnite dans un Irak peuplé grosso modo de trois quarts de chiites, et un pouvoir alaouite dans une Syrie peuplée de trois quarts de sunnites.
Ces fractures ethniques et religieuses se sont donc additionnées aux tensions liées au grand clivage entre acceptation et rejet de la modernité
Après cela, les tensions ont fermenté pendant plus d’un demi-siècle.
Passés les acquis des débuts, les promesses révolutionnaires ne se sont pas réalisées : pas de décollage économique, pas de progrès social, un décrochage vis-à-vis des sociétés développées toujours plus visible. Comme toujours dans ces cas l’opposition - en l’occurrence les salafistes et les Frères musulmans - gagnent toujours de l’audience, même s’ils sont interdits de parole.
Deux générations après l’installation des régimes nationalistes arabes, ce qui semble être une durée « normale » puisque l’on trouve le même laps de temps entre la Révolution française et le Printemps des peuples de 1848, s’est déclenché le Printemps arabe, dont les révolutionnaires se regroupent en deux catégories : d’une part ceux que les occidentaux ont désigné comme « modérés » ou « démocrates », en fait les modernistes souhaitant aller plus loin que les acquis du nationalisme arabe avec l’établissement d’une authentique démocratie et de l’état de Droit ; d’autre part la vieille opposition antimoderniste, salafiste, trouvant enfin à s’exprimer dans l’effervescence révolutionnaire.
On a alors assisté à tout l’éventail des possibilités d’issues des révolutions :
En Tunisie, la transition a eu lieu de manière relativement pacifique, l’armée a pris le parti de la révolution et l’évolution semble se poursuivre vers une démocratie, même si l’environnement géopolitique accentue les fragilités. En Egypte, la transition a commencé de la même manière, pacifiquement, avec le départ de Moubarak, puis l’élection démocratique de Mohamed Morsi, mais le trop fort marquage islamiste de celui-ci a fait dégénérer le mouvement et aboutir au coup d’Etat du maréchal Sissi, qui marque un retour au moins partiel au système ancien.
Enfin, il y a les pays où la révolution a été réprimée et qui a sombré dans la guerre civile : la Libye et la Syrie. Assad a commencé à bombarder sa population, Khadafi a fait de même et a enrôlé des mercenaires venus d’Afrique subsaharienne pour tirer dans le tas.
Dans ces deux pays, les clivages traditionnels ont vite marqué la guerre : minorités, notamment alaouite, contre majorité sunnite en Syrie, et en Libye où Khadafi a eu beaucoup plus de difficultés à réprimer le mouvement en Cyrénaïque qu’en Tripolitaine, où son pouvoir était installé. En Syrie, spécifiquement, les choses ont mal tourné parce que, contrairement à l’Egypte et la Tunisie, seule la partie sunnite de l’armée a été touchée par la défection. C’est le clivage chiite/sunnite qui a ajouté un facteur de conflit dans une situation déjà conflictuelle, et conduit le pays à la guerre civile.
Aujourd’hui, la guerre en Syrie se poursuit, et le chaos règne dans une bonne partie de la Libye, où essaime l’Etat islamique. Des commentateurs prétendent que la situation en Libye est la faute des Occidentaux, qui sont intervenus pour faire tomber Khadafi ; ils sous-entendent que sans cela, Khadafi serait toujours au pouvoir et que l’ordre règnerait.
C’est en réalité improbable : il n’y a guère de raison pour que Khadafi ait pu être capable de faire mieux en Libye que les résultats obtenus par les massacres d’Assad, lequel était au bord de la chute lorsque la Russie a volé à son secours en septembre 2015 ; et cela du seul fait de la révolte et sans intervention militaire occidentale.
S’il n’avait pas été bombardé, le dictateur libyen serait probablement resté au pouvoir plus longtemps, peut-être y serait-il encore aujourd’hui, mais le pays serait dans un chaos similaire à la Syrie, et les groupes terroristes s’y entre-massacreraient avec les mercenaires africains. La porte migratoire libyenne serait tout autant ouverte qu’aujourd’hui.
On va me dire « et l’Irak alors ? il a bien été envahi par les Occidentaux alors qu’il était stable ! Et c’est bien en Irak que l’Etat islamique est né ! »
C’est vrai, l’Etat islamique est né en Irak, et comme force recomposée des sunnites rejetés du pouvoir après la chute de Saddam Hussein ; lesquels se sont alliés avec les révolutionnaires sunnites syriens cherchant de leur côté à prendre le pouvoir détenu par la minorité alaouite. Et puisque les Etats-Unis ont renversé Saddam Hussein en 2003 et écarté les sunnites du pouvoir pour répartir celui-ci plus conformément au découpage ethnico-religieux du pays, alors la faute doit bien en incomber aux Américains ?
En réalité, il paraît bien plus probable que, si les Américains n’avaient jamais mis le pied en Irak en 2003, la situation serait pratiquement la même qu’aujourd’hui.
En effet, si Saddam Hussein était resté au pouvoir jusqu’en 2012, il est peu probable que l’Irak aurait échappé à la vague du Printemps arabe. Sa situation ethnico-religieuse étant inverse, dans ses proportions, à celle de la Syrie, on peut penser que les zones chiites auraient rapidement échappé au contrôle de Saddam, d’autant plus que les rebelles de ces zones auraient bénéficié de l’appui de l’Iran voisin, comme en bénéficie effectivement le pouvoir chiite irakien depuis des années.
Comme Assad, si Saddam Hussein avait survécu, il n’aurait pu maintenir son contrôle que sur les zones chiites d’Irak, et peut-être Bagdad mais de manière très sanglante.
Et naturellement, les sunnites d’Irak auraient été conduits à s’unir avec ceux de Syrie, comme cela été le cas dans l’Etat islamique.
Saddam Hussein n’aurait pas forcément été le chef : il aurait fallu qu’il survive jusque-là, et qu’à 78 ans ils ait toujours été capable de s’imposer. En tout cas, l’Irak et la Syrie seraient à feu et à sang.
Tout comme le serait la Libye si l’Occident n’avait pas bombardé Khadafi.
Dans un cas comme dans l’autre, les choses ne seraient pas très différentes, et surtout n’iraient pas beaucoup mieux, si l’Occident n’avait rien fait.
En réalité, le discours voulant que tout cela est la faute de l’Occident a une chose en commun avec le discours interventionniste : l’idée fausse selon laquelle l’interventionnisme peut changer en profondeur la trajectoire d’évolution d’une société, d’une région du monde.
Le monde arabe est dans l’état où il est actuellement parce que c’est malheureusement le point de passage obligé, et déjà connu auparavant en Europe, vers l’établissement de la démocratie et de la société libre. Tout comme en Europe, il y a des pays où cela se passe de manière plus apaisée et linéaire, d’autres qui sombrent temporairement dans le chaos. Ce chaos n’est pas la faute des Occidentaux, il est le résultat d’une évolution endogène et le produit de facteurs locaux. Le terrorisme a la même cause profonde que le chaos : la lutte entre deux réactions à la modernité. Ce sont des tensions que nous ne pouvons pas purger à la place des pays arabes.
La réaction la plus adaptée est donc de ne pas intervenir. Une intervention comme l’invasion américaine de l’Irak a été aussi inutile que de danser pour faire pleuvoir, mais en coûtant beaucoup, beaucoup plus cher.
J’espère avoir réussi à montrer que l’Occident n’est pas responsable du chaos dans certaines parties du monde arabe, cela n’a donc pas de sens de chercher des excuses dans ce genre au terrorisme ou de verser dans une repentance sans objet.
Mais dans le même temps, les interventions occidentales ont jusque-là été aussi inutiles que coûteuses. Donc, à l’avenir, autant en faire l’économie.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F2%2F1218098.jpg)

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F24%2F12%2F1260171%2F107773568_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F00%2F00%2F1260171%2F107559862_o.png)