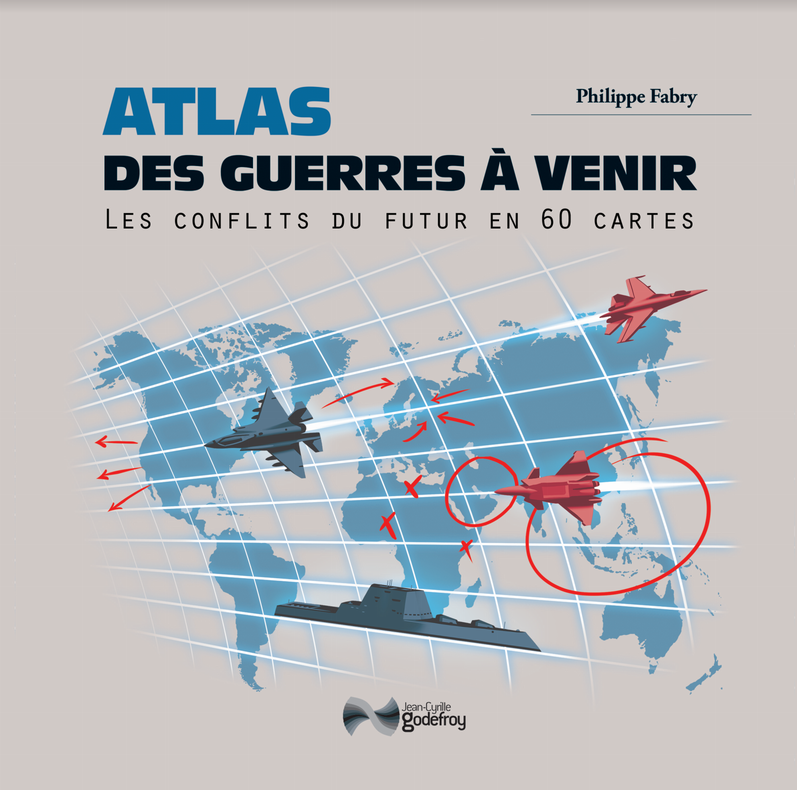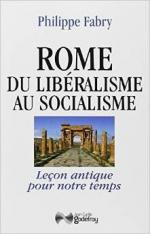La Russie, un autre monde ? Vraiment ?
J’ai lu, avec un profond agacement, un article du Figaro datant d’il y a quelques jours, censé expliquer « pourquoi nous ne comprenons rien à la Russie », le « nous » étant censé désigner les commentateurs occidentaux, dans lesquels l’auteur de l’article ne se comprend pourtant pas puisqu’elle traite les commentateurs d’ignares en prétendant, elle, avoir compris.
Faisant partie des commentateurs qui ont eu envie de dire « Je suis Boris » et de « chanter les louanges » de l’ancien opposant, je me suis naturellement senti visé (quoi que je n’aie pas la prétention de penser, qu’on se rassure, que Mme de Chikoff pensait à moi en écrivant son article, ni même connaisse mon nom ou ait lu une seule ligne de moi, même sur Contrepoints ; il n’empêche qu’ayant eu la même réaction que les commentateurs auxquels elle se réfère, et trouvant cette réaction justifiée, je prends ces reproches pour moi).
Ancienne correspondante à Moscou, Mme Irina de Chikoff fustige la « futilité » des occidentaux, en arguant « Pauvres médias occidentaux! Ils ont avec la Russie bien du mal à faire prendre la bouture. C'est que la Russie est une terre dure! Glacée! Impitoyable aux siens. Et dans la toundra, dans la taïga, quand vous marchez, ca fait: crac! crac! Parce que ce sont des millions d'ossements que vos bottes piétinent! » J’ai du mal à voir en quoi l’analyse est mieux servie par cette littérature.
Eh bien, n’en déplaise à Mme Irina de Chikoff, je pense bien mieux comprendre la Russie qu’elle, spécialement, parce que je l’appréhende avec beaucoup plus de profondeur historique et que je sais voir en quoi les soi-disant traits culturels qu’elle prétend invoquer (ce qui est souvent l’argument des gens qui sont allés en Russie et s’en font autorité, comme si l’analyse consistait à renifler sur place comme un cochon truffier) ne sont pas pertinents.
Ainsi, Irina de Chikoff, comme hélas beaucoup de commentateurs, fait mine de donner de la profondeur à son analyse en rappelant dans quel état était la Russie dans les années 1990. Rares sont ceux qui remontent au-delà de 1917 pour expliquer ce qu’est la Russie, et plus rares encore au-delà du XIXe siècle. Et lorsqu’ils le font, c’est généralement pour rappeler à quel point la Russie est un « autre monde », autoritaire, impérial, mystique, définitivement imperméable aux valeurs en vigueur chez nous, qu’il ne faudrait donc pas juger avec ces valeurs, et laisser défendre les siennes, qui ne valent pas moins que d’autres.
Des idioties, en réalité.
Des idioties, parce que la Russie ne se construit nullement d’une manière différente des autres grands Etat-nations européens à l’histoire longue : Royaume-Uni, France, Espagne, Allemagne. Comme eux elle évolue progressivement, depuis des siècles, d’un ordre féodal vers la démocratie parlementaire dans le cadre de l’Etat-Nation. Elle a simplement pris un peu de retard.
Il serait trop long d’expliquer les mécanismes en détail, j’ai écrit un livre sur le sujet que je compte publier dans les années qui viennent. Cependant, pour résumer, tous les grands Etats-Nations européens se sont bâtis en huit siècles en suivant un schéma toujours semblable : d’abord, la chute d’une entité impériale préexistante et occupant tout ou partie du futur territoire national : le Danelaw pour la Grande-Bretagne (IXe-Xe siècle), l’Empire carolingien pour la France (IXe-Xe siècle), l’Empire des Hohenstaufen pour l’Allemagne (XIIIe siècle) et les empires maures pour l’Espagne (XIIIe siècle). Pour l’essentiel, le décalage historique entre l’évolution de ces différents Etats-nations tient à ce que ces empires préexistants ne se sont pas tous effondrés en même temps.
Le retrait de la puissance impériale laisse la place à une dispersion du pouvoir entre de petites entités locales, au cours du processus de féodalisation.
Ensuite, au sein de cette féodalité, renaît un pouvoir monarchique qui établit peu à peu son autorité, et jette les premières bases de l’Etat-Nation en revendiquant la suzeraineté sur un certain territoire et en lui donnant une identité politique en créant la première assemblée représentative : le Parlement modèle d’Edouard Ier d’Angleterre (1295), les Etats généraux de Philippe le Bel (1302), les Cortes de Castille d’Isabelle la Catholique (1476), la Diète de Maximilien Ier (1495). S’appuyant sur cet organe représentatif qui conforte son autorité et lui permet de s’élever au-dessus des règles de la féodalité, la monarchie évolue vers l’absolutisme, construisant un appareil d’Etat, une administration financée par l’impôt et une armée permanente. Durant la longue phase absolutiste, les frontières définitives du territoire national sont à peu près atteintes et la conscience politique commune de la population l’habitant s’éveille, ce qui débouche sur les revendications de participation au pouvoir, les habitants du territoire ne se percevant plus comme les sujets d’un unique seigneur mais comme les membres d’un corps politique, des citoyens. Cela débouche sur un mouvement de révolution durant quelques décennies, et opérant une mutation de l’absolutisme vers le parlementarisme : 1640-1689 en Angleterre, 1789-1830 en France, 1931-1975 en Espagne, 1918-1949 en Allemagne. Ce parlementarisme évolue ensuite vers la démocratie avec l’extension du suffrage, lente en Angleterre et en France, plus rapide en Espagne et en Allemagne, qui bénéficièrent de l’exemple de leurs aînés.
La Russie a connu exactement le même cheminement : après le retrait de l’empire mongol de la Horde d’Or au XIVe siècle, elle a évolué en monarchie féodale. Avec l’apparition du Zemski Sobor, sous le règne d’Ivan le Terrible, elle a connu l’étape de la première assemblée représentative, ouvrant la marche vers la monarchie absolue. Cette monarchie absolue a duré jusqu’en 1905, date du début du mouvement de révolution russe. En 1917 s’est ouverte la phase aiguë, républicaine-révolutionnaire, de ce mouvement de Révolution, qui fut en Angleterre le temps de Cromwell et du puritanisme, en France celui de Robespierre et du jacobinisme, en Espagne l’époque de la Seconde République espagnole et du Frente popular anarcho-communiste, et en Allemagne d’Hitler et du nazisme. La révolution bolchévique s’est achevée avec la mort de Staline, en 1953, et lui a succédé une étape de dictature militaire post-révolutionnaire (Brejnev n’avait plus rien d’un révolutionnaire) : comme en Angleterre avec le général Monck, en France avec Napoléon, en Espagne avec Franco, en Allemagne avec l’occupation alliée.
Cette étape, nous avons cru qu’elle prenait fin en 1991. Elle l’aurait pu, mais nous savons que la transition démocratique n’a pas été linéaire partout. Elle a bien fonctionné en Angleterre à partir de 1689 ; en Espagne, elle a bien fonctionné mais aurait pu connaître un retour d’autoritarisme si le coup d’Etat de 1981 avait fonctionné. En Allemagne, il n’y a pas eu de problème depuis 1949.
C’est la France qui a connu le parcours le plus chaotique : si la révolution de 1848 a bien été une secousse dans le sens de l’évolution démocratique, en réaction avec une monarchie de Juillet qui ne s’adaptait pas assez vite, en refusant d’étendre le corps électoral contrairement à ce que faisait la monarchie anglaise, l’arrivée de Napoléon III au pouvoir a été une régression, une resucée inutile de la dictature militaire du Ier Empire, au moins dans sa première phase (à force de « réhabiliter » le Second Empire, on oublie presque qu’il se mit en place avec son cortège d’exécutions sommaires d’opposants, et se maintint par l’autorité et la censure, faisant perdre trente ans à la France dans son cheminement vers la démocratie libérale). Mais dans les années 1880, une fois encore, la République a connu le péril de la régression antidémocratique et antiparlementaire avec la crise boulangiste. Finalement, cette troisième tentative échouant comme le coup d’Etat en Espagne de 1981, la démocratie libérale s’instaura bel et bien dans notre pays.
Il en va de même en Russie : en 1991, Guennadi Ianaiev tenta de faire perdurer la phase autoritaire, mais échoua. L’on crut alors que la Russie allait poursuivre son chemin vers la démocratie, mais vint Poutine, qui a opéré la régression. Il est populaire ? Napoléon III l’était aussi, et Boulanger également, c’est ce qui le rendait dangereux. Il n’en reste pas moins, ainsi que je le disais tantôt, une récurrence inutile, qui fait perdre à la Russie de précieuses décennies vers la démocratie, la liberté, la paix et la prospérité.
Contrairement à ce que disent des commentateurs trop nombreux, y compris et surtout des « spécialistes » de la Russie, que leur « spécialisation » rend précisément incapable de percevoir la banalité historique du schéma suivi en ces contrées, la Russie n’est pas un « autre monde », imperméable aux valeurs occidentales. Les valeurs occidentales ne sont pas occidentales, elles sont universelles et communes à toutes les nations ; les nations occidentales y sont seulement arrivées plus vite. Le peuple russe ne pense pas d’une manière définitivement différente des autres, en raison de la slavité, de l’orthodoxie ou que sais-je ; ces traits culturels n’ont d’effet qu’à la marge. Ce qui fait la différence de mentalité entre le russe et l’Européen de l’Ouest, c’est que le « russe profond » a les mêmes conceptions politiques qu’un Français de Corrèze en 1855. Sa méfiance envers la démocratie et la liberté n’est pas consubstantielle à son âme, c’est un habitus qui disparaîtra progressivement, comme elle l’a fait chez les Européens.
Sauf anéantissement nucléaire, on peut espérer qu’une fois Poutine parti, le mouvement reprendra son cours normal, et que personne ne viendra refaire son Brejnev après ça. Cela sera mieux pour le peuple russe, qui le mérite. Encourager les Russes dans l’autoritarisme poutiniste en décidant bêtement que « c’est leur culture », ou estimer que c’est ne rien comprendre à la Russie que d’apprécier l’image de Nemtsov, n’est pas faire preuve d’une compréhension supérieure de la Russie, c’est comme dire qu’une substance fait dormir parce qu’elle a des vertus dormitives. Le degré zéro de l’analyse. Nemtsov, en Russie, est l’équivalent de gens comme Victor Schoelcher ou Jean-Baptiste Baudin en France. Des gens dont les idées ont heureusement fini par triompher.
Jean-Baptiste Baudin en 1851, sur les barricades républicaines s'opposant au coup d'Etat de Badinguet : "Vous allez voir comment on meurt pour vingt-cinq francs !"
Et pour finir : pour ceux que cela intéresse, avec le maréchal Sissi, l’Egypte en est au stade de la dictature militaire post-révolutionnaire. Et oui, cela marche aussi dans de grands pays musulmans.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F2%2F1218098.jpg)



/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F10%2F28%2F1260171%2F120633767_o.jpg)